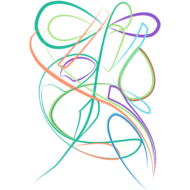La fatigue nous concerne toutes et tous
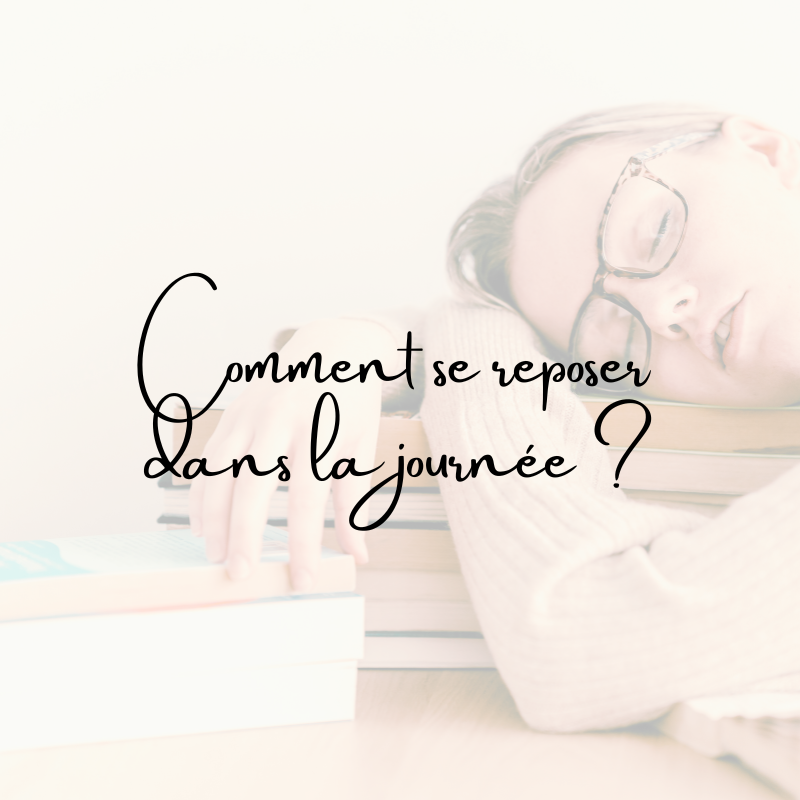
Cette sensation qui parfois nous tombe dessus, parfois s’installe durablement… et qui donne l’impression que, quoi qu’on fasse, on n’arrive plus à récupérer.
Et puis, au moment où sort cet article (issu de l’épisode #002 du podcast), la rentrée de septembre est déjà passée depuis quelques semaines.
Peut-être que les bénéfices des vacances vous semblent déjà loin… Peut-être même que vous commencez à ressentir de la fatigue.
Si c’est le cas, il est important de faire le point, et de mettre en place des choses… avant que la fatigue ne soit trop présente.
Qu’est-ce que le “syndrome de fatigue” ?
Je m’appuie ici sur la description du syndrome de fatigue donnée par le réseau Souffrance et travail, fondé par Marie Pezé.
On y distingue quatre stades :
Stade 1 : la réponse de l’organisme reste dans les limites normales. Les fonctions respiratoires, circulatoires, et le métabolisme sont momentanément augmentés, mais la fatigue disparaît avec le repos.
- En clair : c’est la fatigue passagère, après un effort, et une bonne nuit de sommeil suffit à récupérer.
Stade 2 : La réponse oscillante s’installe lorsque l’effort se prolonge ou se répète à une cadence telle que les mécanismes de récupération ne peuvent que s’amorcer, suivis par une vague catabolique. Il y a des sommations de fatigue non compensées : évolution vers le surmenage.
- C’est à dire : la fatigue s’installe quand l’effort se prolonge ou se répète trop souvent. Le corps n’a plus assez de temps pour récupérer. Même après le repos, on ressent encore de la lourdeur, on se sent moins efficace, comme si les batteries n’étaient jamais complètement rechargées.
Stade 3 : c’est l’évolution pathologique. On peut avoir des troubles digestifs, des douleurs diffuses, de l’irritabilité, de la dépression, des troubles du sommeil, de la lassitude au réveil, un recours au coup de fouet des stimulants.…
- En clair : Là, la fatigue devient chronique. Elle touche non seulement le corps, mais aussi la concentration, la mémoire, les émotions. On a l’impression d’avancer au ralenti.
Stade 4 : c’est le stade de l’épuisement. L’organisme capitule devant les facteurs d’agression. Il y a destruction des mécanismes régulateurs et les dommages peuvent être irréversibles.
- Autrement dit : Le corps lâche, l’esprit aussi. Parfois jusqu’au burn-out.
La fatigue, ce n’est donc pas seulement une question de sommeil et de récupération.
C’est un signal. Un indicateur de l’état global de notre système.
Et plus on agit tôt, plus il est facile de réguler.
NOTE IMPORTANTE : il peut y avoir de nombreuses raisons à la fatigue. Pas seulement le stress dont je parle ici. Elle peut être liée à une apnée du sommeil, un trouble hormonal, un état dépressif, une carence alimentaire ou une maladie. Donc première étape : consulter son médecin et faire un bilan médical.
Le dérèglement du cycle veille–sommeil
Outre une cause médicale, la fatigue peut aussi venir d’un dérèglement du cycle naturel veille–sommeil.
Quand le stress s’installe, il crée une surcharge dans notre organisme :
- Une surcharge physique : tensions musculaires dans le dos, la nuque, la mâchoire… oppression dans la poitrine, palpitations, troubles digestifs…
- Une surcharge cognitive : ruminations, pensées négatives, difficultés de concentration…
- Une surcharge émotionnelle : irritabilité, nervosité, colère, sautes d’humeur…
Notre système est en sur-activation.
C’est comme conduire avec le pied coincé sur l’accélérateur… sans réussir à relâcher.
Et la clé, c’est d’apprendre à s’aider soi-même à décélérer.
À chaque fois qu’on se pose dans la journée, même pour quelques minutes, on aide notre organisme à réduire son niveau d’activation.
Et en faisant ça, on prépare aussi un sommeil de meilleure qualité le soir.
Les façons de se reposer dans la journée
Concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire ?
Il existe plusieurs façons d’aider son corps et son cerveau à souffler un peu.
La micro-sieste ou sieste flash
Elle dure 5 minutes maximum.
C’est un vrai petit reset neuronal.
Quelques minutes de lâcher-prise suffisent à calmer l’hyperactivité, à relâcher les tensions.
Le but n’est pas forcément de dormir, mais de s’autoriser une micro-déconnexion.
Vous pouvez simplement fermer les yeux, ressentir vos appuis, ou vous concentrer sur votre respiration. Juste revenir au corps, ici et maintenant. Ne rien faire de plus. Quelques minutes.
Bien sûr, c’est mieux si vous pouvez vous isoler un peu pendant ce moment.
Je me souviens : à l’école, en début d’après-midi, on nous faisait croiser les bras sur la table et poser la tête dessus. Pas longtemps, mais juste une pause. Eh bien il m’arrive encore de le faire, quand j’ai un “coup de barre” dans l’après-midi.
La sieste classique
Elle est d’environ 20 minutes. C’est la sieste idéale pour recharger la vigilance. Elle est particulièrement utile si vous conduisez ou si vous devez rester concentré longtemps.
Certaines études montrent qu’une sieste de 20 minutes peut améliorer les performances intellectuelles de 20 %.
En revanche, au-delà de 30 minutes, le risque, c’est de plonger dans un sommeil profond, comme au début de la nuit.
Et là, le réveil devient difficile. On se sent « dans les vapes ». C’est ce qu’on appelle l’inertie du sommeil.
Et enfin :
La sieste royale
La sieste d’environ 90 minutes. Cette sieste correspond à un cycle complet. Elle permet de rattraper une dette du sommeil.
Deux choses à retenir question fatigue
- Il est important de ne pas laisser la fatigue s’installer.
- Le repos, ce n’est pas seulement la nuit.
Chaque pause dans la journée, même de quelques minutes, est une mini-invitation à réduire l’activation, à souffler, à donner au corps et au mental l’espace dont ils ont besoin.
Moins de tensions. Moins d’irritabilité. Plus de concentration.
Ces petits moments de repos et de récupération comptent énormément.
Mais il est important aussi de se ressourcer. Et est-ce que vous faites la différence entre, se reposer et se ressourcer ?
La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exténué par le rythme brutal de la ville. Dany Laferrière